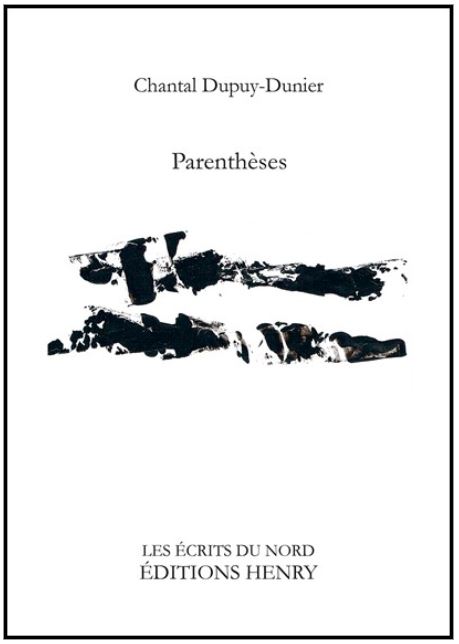|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues
papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de
livres... |
|
|
LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Printemps 2025 Chantal
Dupuy-Dunier : Parenthèses Les écrits du nord.
Éd. Henry, 2023, 120 p. 15€ (Prix Paul
Verlaine 2024 de la Maison de Poésie) Note de lecture de
Dominique Zinenberg |
|
« Ceux qui les referment sont les mêmes qui les ont
ouvertes » : on ouvre une parenthèse en naissant, on la referme en
mourant ; or dans ce recueil en deux volets, la poète déplore d’une part
la mort de son père ; d’autre part celle de sa mère. Deux temps de
deuil, deux retours à leur vie. C’est le chagrin lui-même qui donne accès au
récit fragmenté de la vie du père, puis de la mère. Dans la mort, le père est
enterré ce qui fait surgir des visions de putréfaction, liquéfaction,
disparition lente : « À présent Tu n’as plus de bouche, plus d’estomac pour boire les
jours, pour goûter la vie. Tu n’as plus la
vie. « Plus »,
selon la prononciation, signifie davantage
ou privation définitive, c’est étrange. »
La plongée dans le
manque du père se distille goutte à goutte en jours, en mois et cela semble
s’arrêter au bout d’un an. Le père mort, la seule chose à faire pour
neutraliser le chagrin c’est de tenter « de parler encore de lui, /
seulement de lui, / avec toute l’ambiguïté d’un sujet qui n’existe
plus. » Ce qui est très
sensible dans les poèmes consacrés au père c’est l’art de la poète de
suggérer le temps qui passe par l’érosion progressive d’un vers à chaque
étape de la première année de deuil : « Un mois
déjà. Là-haut, ton
corps se dissout petit à petit… » (p.29) « Sept mois
déjà. Là-haut, ton… »
(p. 49) « Huit mois
déjà. Là-haut… »
(p.52) « Neuf mois
déjà … » (p.55) C’est l’éloquence
par le rétrécissement concret du vers jusqu’aux points de suspension
remplaçant les mots, mimant le travail du temps sur la dissolution des
chairs. Ces flashs
macabres envahissent l’espace du poème et cela jusqu’au dernier poème que la
poète lui consacre : « À présent,
j’ai pour père un cadavre qui continue de se
décomposer en se mêlant à la
terre et aux autres morts. Nous ne jouons plus
dans la même cour. Tu t’es
définitivement tu. » (p.64) Dès après sa mort,
ce qui frappe la fille devenue orpheline c’est la métamorphose qui s’est
opérée en lui, son père. « changé en un autre que mon père ». Il
est devenu méconnaissable : « Qui c’est / le monsieur émacié/ couché dans
la pénombre comme une statue de cire ? » Pourtant elle
prend le parti de s’adresser à lui, de lui parler en lui disant
« tu » tout en ayant conscience qu’elle le fait « avec toute
l’ambiguïté d’un sujet qui n’existe plus. » Elle se débat avec ce besoin
de le tutoyer comme s’il entendait encore et l’absence bien réelle qu’elle
expérimente. Des fragments de
la vie du père émaillent les poèmes : sa rencontre avec sa mère, son
métier d’ingénieur : « Tu faisais la fierté de la Berthe, / un fils de
paysan devenu ingénieur. », sa maladie : « son pitchoun, le
Guy, interné chez les fadas. » Ainsi
parallèlement à sa disparition (un peu comme le fait Jean-Philippe Toussaint
dans son récit La Disparition du paysage), Chantal Dupuy-Dunier retrace
quelques éléments de la biographie de son père donnant voix à ceux qui ont
connu sa famille, voix de commérages, que l’on sent plus ou moins
bienveillantes. « Passe,
impair et manque » voilà comment la poète a titré ce premier volet. Ce
lexique qui appartient au jeu de la roulette ou de la boule au casino n’est pas
sans ambiguïté. S’il suggère le hasard, la loterie ou le destin, il joue
aussi sur les signifiants dont la psychanalyse fait son miel :
« Passe » comme le fait de passer de vie à trépas et transmission
d’une hérédité, d’un savoir ou d’un héritage : « C’est toi qui m’as
offert les mots-jouets, / pas ceux de tous les jours, / les outils de la
poésie. » ; « impair » comme « un père » ;
et l’évidence du sens de « manque » pour tout lecteur. Avec la
disparition de la mère, le même processus de deuil est à l’œuvre, mais ce qui
traverse les poèmes ce sont des images de feu, puisqu’elle a été incinérée. « Deux heures coulent dans le sablier pendant que ta
fumée monte au-dessus de la colline. L’air tremble à son
passage. La Mort au masque
de céruse se lave les mains dans nos fontaines * Les nuages
porteront peut-être ton deuil. » *Saint John Perse « Laisse de
mère » est le titre choisi pour le volet poétique consacré par l’autrice
à sa mère. Là encore les signifiants abondent : laisse comme abandon, laisse
comme forme poétique dans les chansons de Geste ; laisse comme lien
solide et comme éloignement, mais aussi bande de débris que les marées
déposent sur le sable en « laisse de mer » : « Tu me
délaisses, je te délaisse. C’est comme une
comptine… Une comptine pour
faire peur aux enfants
méchants. Je te délaisse, tu me délaisses. Petit à petit, tu te délaisses, tu abandonnes ton
corps, tu t’endors dans
tes yeux pour éprouver
l’approche de la mort. » (p.71) À l’inverse du mot
« Impair » qui cache le mot « père », le mot mère cache
la mer. On la retrouve dans le sillon des poèmes de façon allusive :
« comme une empreinte humide sur la grève », « comme
l’intérieur charnel d’un coquillage », « Ô la conque », « sur
l’estran », « l’ultime retrait de la marée », « Poisson
sorti de l’eau … // poisson mort », « Placenta méduse, / étoile de
mère morte. / près d’un château de sable », « Tu nous as donné les
ailes des goélands », « comme des galets dans l’espace de l’estran. »,
« Ta mort, un phare/ dont le feu aveugle », « comme le creux
sombre des vagues. » etc. « Comment peux-tu t’effacer, devenir ce sable broyé sur le rivage d’une île étrange ? Laisse de mère, un peu de silice qui crisse sous les dents
de la mémoire. » Le lecteur
pressent une histoire complexe entre la mère et la fille. Une histoire de
liens puissants tissée par les contes et les comptines, par le lait des
ressemblances qui se confirment quand la fille orpheline se regarde dans le
miroir : « Dans mon miroir, / c’est ton visage éteint que
j’aperçois désormais. / En vieillissant, je te ressemble, ma mère. »
Mais c’est aussi une histoire dramatique qui se dessine entre sa mère et
elle, une histoire d’éloignement, d’absence, « Je ne serai pas là pour
tenir ta main » et dans cette solitude de la mort de la mère se niche un
des malheurs de sa vie : le sentiment d’abandon « Quatre abandons,
ma mère ». Se dégage un portrait de beauté « Belle, si belle ma
mère » ; de vie amoureuse compliquée, de déplacements, de force et
courage : « Mais toi, si forte / trop peut-être, / jusqu’aux chutes
et aux mains en serres d’oiseau, / jusqu’à l’île atroce, / jusqu’à l’aile
violente du feu. » Si la mort du père
a fait surgir chez notre poète des images obsédantes de désintégration
physique dans la terre où il repose, elle fait surgir, pour la mère, des
images de destruction physique pendant la dernière partie de sa vie. Il a
suffi de peu de mots pour décrire la dégringolade physique et psychique de la
mère jusqu’à l’annonce par « Sœur » de sa mort. L’annonce de la
mort de la mère dans le recueil rappelle les premières phrases de L’Étranger d’Albert
Camus. C’est la même fausse froideur, la même pudeur, la même lucidité :
« Est venu le
temps de Maman est morte… Sœur a envoyé un message : « Maman nous a quittés ce matin. » Elle n’a quitté aucun de ses quatre enfants, elle est morte, seule. » Un recueil
s’ouvre, un recueil se referme comme on ouvre et comme on referme une
parenthèse. Ce sont des choses apparemment banales que l’on fait
souvent ; d’autant que ce signe de ponctuation peut signifier que ce que
contient la parenthèse pourrait être supprimé, sans rien modifier d’essentiel
à l’ensemble. Une vie est-elle aussi dérisoire que cela ? Une vie, a
fortiori deux, comme dans cet ouvrage, pourraient-elles être négligeables,
accessoires au point que n’en rien savoir, n’en rien dire passerait inaperçu,
n’aurait pas d’importance ? Chaque vie, à ce compte, est parenthèse,
mais ce qui se trouve enclos dans toute parenthèse est unique et sacré, du
premier au dernier souffle, et l’écrin de poésie que la poète consacre à ses
parents est parenthèse vitale, parenthèse essentielle, car n’est-ce pas dans
la parenthèse elle-même que se trouve le vrai secret, qui est digression,
fragilité, connaissance et beauté ? © Dominique Zinenberg |
Note de lecture de
Dominique Zinenberg
Francopolis - Printemps 2025
Créé le 1er mars
2002