|
Mes
deux sous de raisons sont finis.
Rimbaud
Poursuivant ici une longue enquête
sur les ouvrages (livres ou revues) consacrés à Rimbaud, nous faisons cette
fois un retour en arrière avec deux livres publiés pour la première fois l’un
en 1933 et l’autre en 1991.
(*)

Rimbaud le voyou
Qui, alors qu’il était autorisé à
quitter le camp de Drancy, refusa d’en sortir sans sa sœur qui était internée
avec lui, se vouant ainsi à une mort presque certaine ? De fait, ils
finiront assassinés dans une chambre à gaz, en octobre 1944, ayant fait
partie de l’avant-dernier convoi vers Auschwitz. On rappelle ici la mémoire
de l'écrivain né Benjamin Wechsler en 1989 à Jassi
(Iaşi), d’abord roumain et roumanophone sous le pseudonyme B. Fundoianu puis francophone et français sous le nom Fondane que nous lui connaissons. Que nous lui connaissons ou pas, car son nom n’évoque sans doute plus
grand-chose au public français, alors que Fondane
fut entre les deux guerres l’auteur reconnu sinon célèbre de nombreux essais
qui se distinguent par leur originalité, essais philosophiques, articles ou
livres comme La Conscience malheureuse (1936) ou Faux traité
d’Esthétique, Essai sur la crise de réalité (1938) et des essais
consacrés à deux de nos poètes majeurs, Rimbaud et Baudelaire. Poète lui-même
(Le Mal des fantômes qui rassemble son œuvre poétique en français,
publié à titre posthume en 1980, a connu depuis plusieurs rééditions), il fut
par ailleurs dramaturge, cinéaste.
Rimbaud le voyou et l’expérience
poétique (1933) est
le premier ouvrage publié par Fondane après son
arrivée en France, dix ans plus tôt. Ce livre, lui aussi plusieurs fois
réédité, est disponible désormais grâce aux Éditions Non Lieu avec une préface de Michel Carassou. Il mérite certainement d’être lu encore
aujourd’hui, son approche de la personnalité du poète n’ayant rien perdu de
son originalité. On ne trouvera pas ici en effet une analyse littéraire, Fondane ne s’intéresse pas aux procédés stylistiques du
poète, il ne cherche pas non plus – comme tant d’exégètes de nos jours – à
décrypter un sens caché sous des formules plus ou moins absconses. Il veut
comprendre la trajectoire véritablement extraordinaire d’un jeune génie qui
renonça brutalement à la poésie et dont la reconversion en aventurier
assoiffé d’or en Abyssinie apparaît comme une sorte de suicide
intellectuel. L’explication la plus simple, partagée par de nombreux
interprètes (en particulier catholiques, comme Claudel ou Jacques Rivière),
largement influencée par les écrits de la sœur d’Arthur, Isabelle, est celle
du repentir. Le poète Rimbaud était un mauvais garçon ; dans Une
saison en enfer il aurait renoncé tant à la poésie qu’à une vie de bâton
de chaise. Cette explication présente deux faiblesses : d’abord, la
lecture attentive d’Une saison peut laisser quelques doutes quant à la
réalité de ce repentir ; par ailleurs il n’est pas certain que cet
ouvrage marque véritablement la fin de la période d’écriture de Rimbaud.
Rappelons à cet égard que s’il n’existe aucun doute quant à Une saison
(publié en 1873), on se dispute encore sur les Illuminations qu’on ne
sait pas dater précisément entre 1872 et 1875. Cependant l’ouvrage d’Henry de
Bouillane de Lacoste, qui a soulevé ce lièvre, date
de 1949. Pour Fondane il demeurait acquis qu’Une
saison marquait bien la fin de la vie de Rimbaud poète. Il en fait le
moment clé de la (re)conversion du poète en commerçant aventurier.
Bien que Fondane
manie parfaitement la langue française, la lecture de Rimbaud le voyou
est loin d’être aisée. Et pas uniquement parce que les vingt-sept chapitres
sont dépourvus de titre, ce qui n’aide pas à s’y retrouver. La thèse de ce
livre qui laisse l’impression d’avoir été écrit sans un véritable plan est
difficile à cerner. Si le titre indique bien que l’auteur va s’intéresser au
poète rebelle et provocateur que fut le jeune Rimbaud, le livre traite de
bien d’autres aspects de la personnalité du poète. D’ailleurs, comme Fondane le note dans la préface qu’il avait préparée pour
une seconde édition, son message n’a pas été compris par les premiers
lecteurs. Comment « se peut-il que personne n’ait compris, ni voulu
comprendre, que le « voyou » était pour moi le contraire du héros,
du saint, du juste – des hommes qui ayant satisfait à la Loi y ont trouvé
leur béatitude – et que par là, des antipodes
mêmes, naissait une nouvelle sainteté, des piétineurs
de la Loi, des martyrs de la raison, des non-conformistes de
l’être ? ». Mais Fondane ne conclut-il
pas cette même préface en soulignant que le génie est « obscur »,
autant qu’il est « fou » ? N’est-ce pas reconnaître que
Rimbaud gardera toujours une part de mystère, autant pour ses interprètes que
pour leurs lecteurs ? D’ailleurs, conscient des imperfections de ce
premier essai, Fondane avait rédigé des nouvelles
versions des chapitres 4 à 8 du livre déjà publié qui sont reproduites à la
fin des éditions suivantes. Ces ajouts, de même que les notes de la première
édition sont précieux.
La vie de Rimbaud est faite de
reniements successifs. On connaît celui, sincère ou non, d’Une saison
mais Fondane en repère davantage :
1. L’abandon des illusions de
l’enfance : la phase du « voyant » ou du « voyou »
2. La recherche d’une profession
lucrative et le départ en Afrique
3. À la soif de l’or se superpose
bientôt l’idée de l’exploration (publication du Journal de route dans le
Harar dans le Bulletin de la Société de géographie)
4. Le rêve du mariage et d’une vie
rangée
5. Le retour à la foi de son enfance
ou un ultime reniement
Le dernier point mérite
une explication. Pour un Claudel, la conversion de Rimbaud sur son lit de
mort ne faisait aucun doute. Rimbaud était « un mystique à l’état
sauvage ». « Sa vie un malentendu, la tentative en vain, par la
fuite, d’échapper à cette voix qui le sollicite et le relance, et qu’il ne
veut pas reconnaître ; jusqu’à ce qu’enfin, réduit, la jambe tranchée,
sur ce lit d’hôpital de Marseille, il sache ! ». La conviction
claudélienne d’un retour du religieux chez Rimbaud se fonde sur le témoignage
d’Isabelle qui accompagna le poète dans ses derniers jours. Le doute de Fondane à ce même sujet s’appuie pour sa part sur un
passage de la lettre dans laquelle Isabelle, après avoir raconté à sa mère la
confession d’Arthur (« je n’ai jamais vu de foi de cette qualité »
aurait dit l’aumônier auquel il s’était confessé), rapporte des propos plus
troublants de son frère, à la suite de la confession : « Crois-tu,
dis, crois-tu ? » Et : « Oui, ils disent qu’ils croient,
ils font semblant d’être convertis ».
Que Rimbaud ait retrouvé
ou pas la religion de son enfance, il est important de rappeler les étapes de
la vie du poète car elles sont au cœur de la démonstration de Fondane. Elles caractérisent selon lui l’instabilité
existentielle de Rimbaud, son insincérité foncière manifestant une haine de
soi comme du genre humain en général. Dans la première note du livre, in
fine, intitulée « Hypothèses », Fondane
esquisse une explication de cette haine de soi par l’impuissance sexuelle.
S’il n’en existe aucune preuve formelle, divers écrits de Rimbaud fournissent
bien en effet des indices : des poèmes comme « Vénus
anadyomène » et certaines notations comme échappées de la plume du
poète. Ainsi « L’horrible quantité de force que la nature m’a toujours
refusée », « le fils du soleil », « moi je suis intact et
ça m’est bien égal » et pour finir « je n’aime pas les
femmes ». On retiendra surtout, peut-être, l’absence de toute preuve du
fameux « dérèglement de tous les sens » dans le domaine sexuel.
Même dans la trouble relation avec Verlaine, si une homosexualité active, en
tout cas une inclination envers les garçons sont avérées chez l’auteur des Poèmes
saturniens, il n’existe rien de tel en ce qui concerne Rimbaud.
Alors le génie de
« l’homme aux semelles de vent » est-il une simple affaire de
sublimation ? Peut-être. On ne tranchera pas là-dessus ; nul ne
niera en tout cas les tourments du poète. « Il s’agit de faire l’âme
monstrueuse, à l’instar des comprachicos »,
est-il dit dans la lettre du voyant. Alors monstrueux Rimbaud ? Non,
mais tourmenté sûrement. En dépit de toutes ses imperfections le livre de
Benjamin Fondane apporte à cet égard plus que des
lueurs et vaut sans aucun doute d’être lu encore aujourd’hui.
° °
°
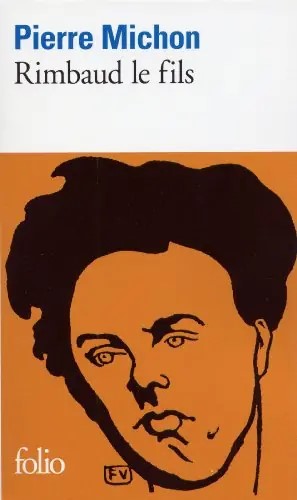
Rimbaud le fils
Parmi les nombreux ouvrages
intitulés « Rimbaud le » suivi d’un qualificatif variable, qui ont
fleuri en particulier au cours des années récentes (2), le plus connu, dont
la première édition remonte à trente-cinq ans en arrière et qui est constamment
réédité en poche, est sans conteste le Rimbaud le fils de Pierre
Michon. Un petit bijou littéraire à l’intérieur duquel les amoureux de
Rimbaud retrouveront leur héros magnifiquement servi par l’une des plus
belles plumes des lettres françaises. Il s’agit d’une « biographie
libre » qui s’autorise à imaginer à propos des relations de Rimbaud avec
ses proches – en premier lieu sa mère, d’où le titre – des détails inconnus
des biographes les plus respectueux des faits. Le livre n’en est pas moins à
recommander à tous les amoureux du poète, en particulier mais pas seulement
ceux qui souhaitent aller à la découverte de l’homme sans entrer dans les
controverses des érudits.
Michon soulève quand même en passant
l’un des points de la personnalité de Rimbaud considéré comme problématique
par Fondane – avait-il du « goût » pour
les femmes ? – et conclut à la vanité de ce débat : un avis qu’on
peut ou non partager mais de telles questions ne sont en effet pas celles qui
intéressent Michon qui n’est jamais aussi bon que lorsqu’il se laisse aller à
inventer, par exemple ces définitions de la poésie qu’il prête à Izambard, le
professeur de Rimbaud.
« Si, entrant dans sa classe
[…] vous lui aviez demandé ce qu’était à ses yeux la poésie […] il aurait
répondu sur un ton d’audace et de panique que c’était une affaire de cœur
grâce à quoi la langue est parée comme une mariée, ou alors depuis Baudelaire
les yeux faits, vérolée, mais glorieuse et parée comme une haute
putain. »
Selon Michon, Rimbaud « cessa
pratiquement d’exister quand le verbe s’effondra ». Ainsi explique-t-il
la fuite de Rimbaud, le départ en Afrique, la reconversion en commerçant si
soudaine de la part d’un ancien vagabond, parce que le génie poétique l’avait
abandonné. Il n’avait plus le feu sacré, pourrait-on dire. Il aurait certes
pu continuer à écrire des « beaux poèmes », comme tant de tâcherons
de la plume, mais il n’avait pas cette envie-là, « c’est-à-dire négocier
en sachant bien que le négoce est truqué, le roi qui est dans le poème jette
à chaque pesée son épée d’or dans la balance, il faut recommencer, accumuler
dans son plateau à soi des années de paperasses sans que le fléau de la
balance bouge d’un cheveu. » Les poètes parmi nos lecteurs apprécieront.
Notes
(1) Baudelaire ou l’expérience du
gouffre sera publié à titre posthume en 1947.
(2) Rimbaud le voyant de
Rolland de Renéville (1929, ouvrage critiqué par Fondane), puis Rimbaud l’homme qui parlait en silence
de Joseph Giudicianni (2007) et deux BD, Rimbaud
l’indésirable de Xavier Coste (2013), Rimbaud l’explorateur maudit
de Philippe Thirault et Thomas Verguet (2016). Une
liste limitée à la France et peut-être incomplète.
© Michel Herland
(*)
Benjamin Fondane, Rimbaud le voyou et
l’expérience poétique (1933). Réédition avec une préface de Michel Carassou, Paris, Non Lieu,
2010, 240 p., 15 €.
Pierre Michon, Rimbaud le fils (1991).
Dernière réédition en Folio, 2023, 128 p., 6,90 €.
|