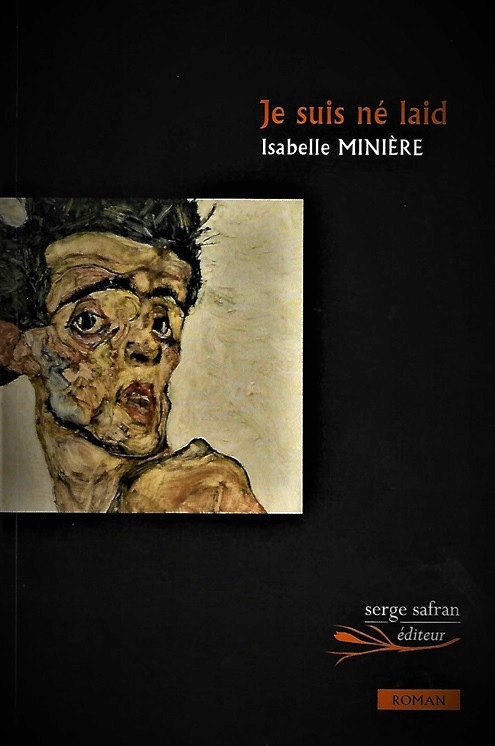|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Petite note de lecture de
Dominique Zinenberg :
Je suis né laid d’Isabelle Minière
(Serge Safran éditeur, mai
2019)
Depuis
que j’ai commencé à lire isabelle Minière j’entends clairement une voix à
travers les mots, la scansion et les thématiques choisies, une voix
reconnaissable qui emprunte le chemin d’un univers bien concret, bien ancré
dans des problématiques de notre temps : l’état du couple, les
défaillances, les obsessions, le rapport gauche, incertain à soi et aux
autres, les incompréhensions et blessures narcissiques, tout un travail de
fourmi pour trouver un équilibre que l’on pressent de toute façon toujours précaire,
une recherche infatigable (malgré les parenthèses mélancoliques ou
angoissées) du bonheur à deux. La quête affective, le désir d’être aimé
parcourent chaque histoire et se modulent avec humour, sensibilité,
constance. Avec Je
suis né laid, le personnage d’Arthur, le narrateur de l’histoire, la
tâche promet d’être rude et l’auteur a placé la barre bien haut, car ce qui
le distingue de tous les autres c’est une extrême laideur qui lui ferme
d’emblée, à la naissance même, les portes légitimes du bonheur. Une lutte
acharnée s’engage, un combat titanesque se livre pour que, malgré la fatalité
qui frappe le bébé du sceau de la laideur dès la naissance, le protagoniste
parvienne à être accepté tel qu’il est, crée des liens, soit aimé et que
par-delà son handicap physique, il soit reconnu pour une vraie personne
respectable en tant que telle et douée comme chaque humain non seulement
d’intelligence mais de sensibilité et de sociabilité. Le lecteur suit Arthur depuis avant sa
naissance, du temps où les parents (un beau couple amoureux) rêvaient de leur
futur bébé et préparaient sa venue avec tendresse ; et le lecteur suivra
Arthur jusqu’à tard dans sa vie d’homme. Toutes les étapes de douleur, de
rejets au quotidien, toutes les blessures narcissiques à chaque palier de la
vie sont racontées avec minutie : le maléfice de la naissance agissant
d’entrée de jeu, créant un traumatisme qui se joue et se rejoue dans l’infini
des jours, puisqu’il est réactivé chaque fois que quelqu’un voit Arthur.
Choc, rejet, répulsion, gêne, fuite : l’enfant est sans cesse ramené à
son infirmité. C’est un ressenti qui conduit ses parents à le cacher, le
rendre aussi peu visible que possible et le bébé puis l’enfant à se tenir en
retrait, à s’isoler pour éviter d’être mis en retrait et isolé, abandonné,
laissé pour compte par les autres. Très vite la stratégie de défense du petit
« Tutur », c’est de faire profil bas, se
taire, s’abstraire, ne pas embêter ni gêner, tout faire pour passer inaperçu.
Toute l’aventure du roman se tient dans cet objectif singulier : réussir
à passer inaperçu ! Contrairement à Amélie Nothomb dans Attentat qui décrit avec précision et
perversité jusqu’à l’invraisemblance et le grotesque le plus appuyé le
physique de son héros hideux, Isabelle Minière ne le décrit jamais. Elle ne
décrit que son corps « normal », voire musclé, sa taille élancée.
C’est sa tête qui fait peur, qui surprend, qui occasionne de façon quasi
automatique chez les gens, le mécanisme de rejet comme si voir Arthur c’était
être face à un monstre répulsif. Le lecteur compte les coups que reçoit le
personnage et se souvient à travers au moins un exemple de rejet l’effet que
produit l’impression d’être rejeté, d’être isolé dans la cour de récréation,
d’être perçu comme quelqu’un d’à part qui ne fait pas corps avec les autres,
que l’on désigne comme « étranger » au sein du groupe, voire au
sein de l’humanité. D’une manière ou d’une autre, chacun a expérimenté ce
chagrin d’être méconnu, ignoré, ostracisé ne serait-ce que de façon fugace.
C’est pourquoi Arthur est si attachant. Il est frère d’infortunes enfouies,
de blessures narcissiques plus ou moins cicatrisées. Sa souffrance
exponentielle au fur et à mesure qu’il grandit, que son besoin légitime des
autres grandit, est comprise, intimement, comme souffrance personnelle, même
si la cause a pu en être tout autre. La solitude d’Arthur est un puits sans fond
malgré l’amour que lui portent ses parents et quelques rares personnes au fil
des pages. La solitude et le plaisir solitaire, l’impossible sexualité qui, à
l’adolescence, tourne presque à l’obsession, l’interrogation sur le sens
d’une vie dont on semble banni, le désespoir qui gagne, les idées suicidaires
qui affleurent, mais ce courage toujours, cette renaissance raisonnée par les
études, l’espoir puisé on ne sait dans quel recoin obscur et lumineux de soi
qu’on finira par être accepté, qu’on aura un ami, une petite amie, tout ce
qui donne sens à l’existence qu’Arthur fait renaître de ses cendres, tout
cela permet de lire cette histoire comme un conte. À la naissance, l’enfant reçoit un
maléfice : il est laid ; puis il devra suivre une série (infinie)
d’épreuves dans lesquelles il rencontrera des adjuvants : le père, la
mère, Kouki, Alph, son
double Arthur, quelques médecins, Kali ; et des opposants, très nombreux
avec lesquels les combats seront souvent redoutables ; il subira de
vaines métamorphoses, devra relever de sérieux défis mais je n’ai pas comme
mission de déflorer l’histoire, il vaut mieux la lire n’est-ce pas ? […] Je
m’étudiais moi-même par la même occasion. Moi et ma laideur, l’influence de
mon physique sur mes réactions, mes pensées, ma vision du monde… Vision du
monde assez triste et assez simpliste : si tu as la chance d’être beau,
tu seras plutôt heureux, chanceux sur tous les tableaux ; si tu as la
malchance d’être laid, tu seras malheureux sur tous les tableaux. Ma laideur m’avait
tourné la tête. Un sentiment d’injustice tout à fait stérile (pourquoi moi et
pas lui ?) Une colère sourde qui ne s’entendait pas, qui ne se voyait
pas - j’étais très calme, très courtois et surtout très discret. Quand on a
une gueule comme la mienne, on ne se pavane pas. On espère que les apparences
sont trompeuses, et que sous l’emballage effrayant se cache quelqu’un de
bien, quelqu’un qui vaut la peine : il me venait parfois, pour me
réconforter, l’image d’un bijou enveloppé dans une feuille de papier
toilettes. Bijou de pacotille sans doute, bijou quand même, mais enveloppe
omniprésente. (p.75) La laideur peut se retourner en beauté par
l’art et par l’humanité ou le cœur. Dans son roman, Isabelle Minière fait la
part belle aux deux. Même si Arthur a une tendance au mutisme,
qu’il limite sa conversation au strict minimum, le lecteur a accès à ce qu’il
ressent et au flot d’émotions qu’il laisse déborder dans sa narration. Ses
émotions se manifestent souvent par une violence verbale, une surabondance de
grossièretés, le flot de termes péjoratifs pour décrire ce qu’il appelle
« sa gueule ». Il ne s’autorisera le mot si beau de visage qu’à
partir de la page 141, de temps en temps, avec parcimonie, comme s’il n’avait
pas droit à ce terme si cher à Levinas, terme qu’il a valorisé dans son œuvre
au point d’en faire un de ses concepts les plus importants car ce que l’on
voit d’abord de l’autre c’est le visage ou plus précisément la vulnérabilité
qu’il exprime. Le plus vulnérable des visages est celui d’Arthur dans sa
laideur radicale ; or voilà que chacun se détourne de ce visage dont la
vulnérabilité est à proprement parler insoutenable. Il faudra tout un roman
pour que la gueule d’Arthur devienne un visage et que chacun puisse se sentir
responsable en le regardant et que son humanité, évidente au lecteur, soit
accessible au tout venant ! Merci Isabelle pour ce texte qui interroge,
ressuscite nos cauchemars mais aussi nos rêves et nos élans. Merci d’accorder
des chances à tes personnages, de les soutenir si fort qu’ils parviennent à se
frayer un chemin de vie dans ce dédale d’injustices et de vexations. |
Note de lecture
de
Dominique
Zinenberg
Francopolis, mai-juin
2019