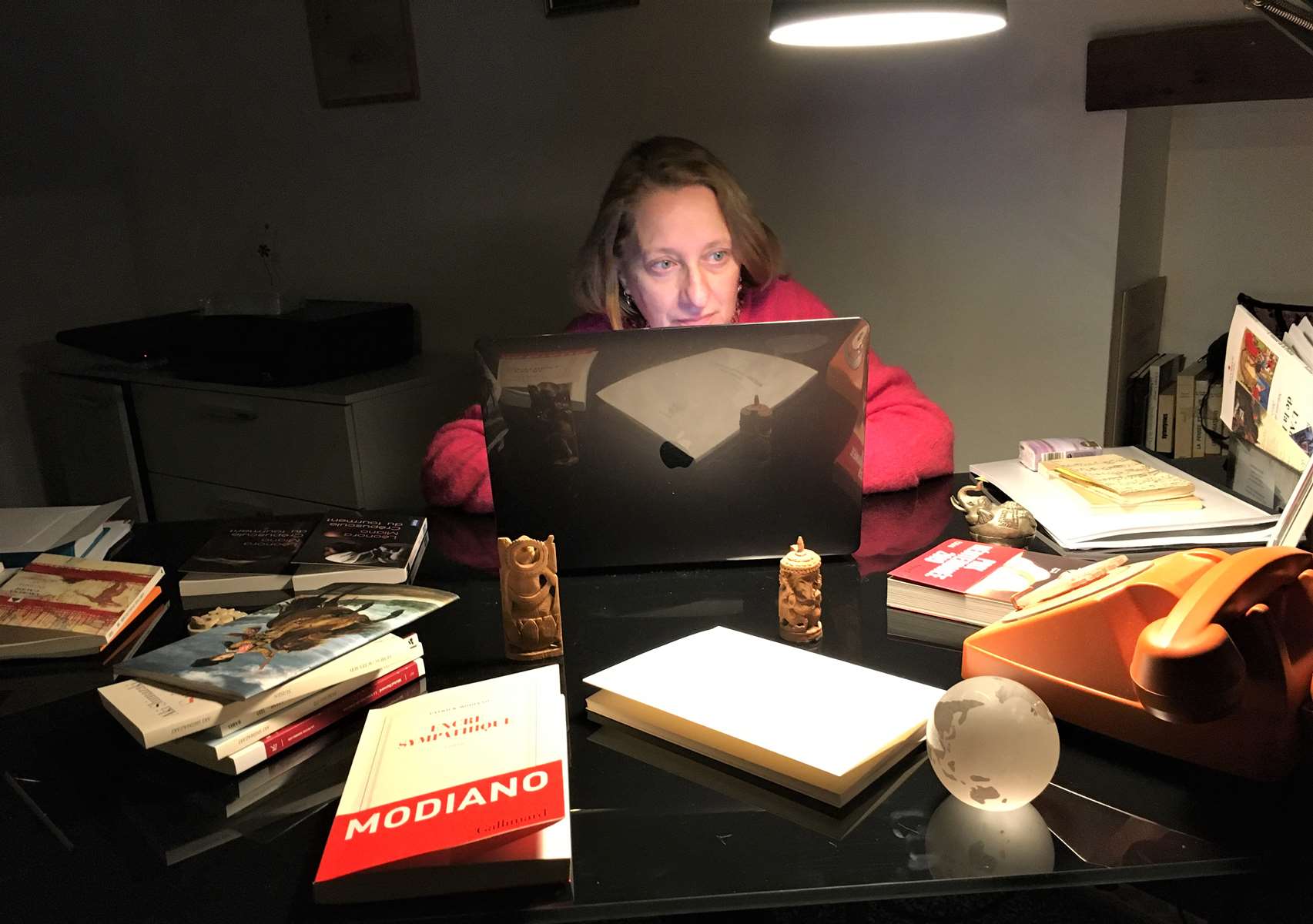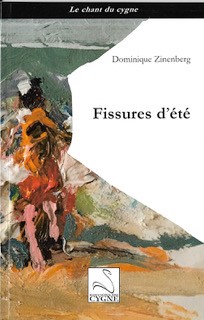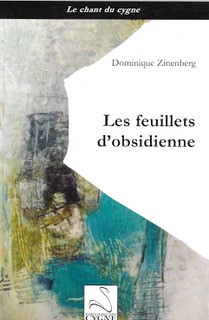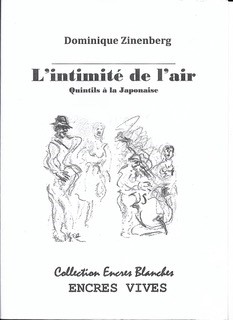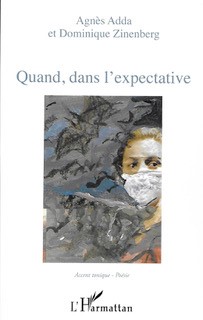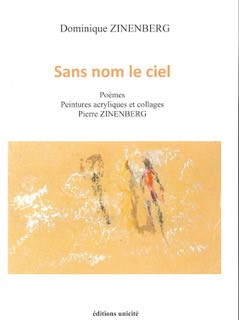|
|
|
|
|
|
GUEULE DE MOTS
Cette rubrique reprend un second souffle en 2014
pour laisser LIBRE PAROLE À UN AUTEUR... Libre de s'exprimer, de parler
de lui, de son inspiration, de ses goûts littéraires, de son attachement à la
poésie, de sa façon d'écrire, d'aborder les maisons d'éditions, de dessiner
son avenir, nous parler de sa vie parallèle à l'écriture, ou tout
simplement de gueuler en paroles... etc. Septembre-Octobre 2021 Libre parole à Dominique Zinenberg En entretien avec François Minod |
|
François
Bonjour
Dominique, Je
suis très content de passer un moment avec toi. Comme tu le sais, je suis
très sensible à ton écriture. J'aimerais qu'on parle de ton travail de poète,
d'écrivain mais aussi de critique parce que tu fais des fiches de lecture
pour différentes revues, dont Francopolis. Pourrais-tu
nous dire tout d'abord depuis quand tu écris et qu'est-ce qui t'a décidé à
publier tes premiers textes ? Dominique J'ai
commencé très jeune. À partir du moment où j'ai su écrire, j’ai écrit des
petites chansons, des petites choses un peu rigolotes, notamment pour mon
petit frère. J'écrivais aussi de grandes lettres à mes parents quand j'allais
en colonie de vacances. Avec des tas de fautes d'orthographe et
d'imprécisions grammaticales. François Tu
avais quel âge ? Dominique J’avais
sept ou huit ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé un journal pour faire
comme Anne Frank que je venais de lire et qui était devenue mon modèle. Dans
mon journal, je recopiais systématiquement tous les petits poèmes que j'avais
écrits. J’ai tout gardé. Le papier des cahiers d’écolier a jauni ! Mais
paradoxalement je n’ai été publiée qu’à partir de 2014. Quand
on a réussi, par chance ou parce qu'on vous y a poussé, à franchir le pas et
à être publié, il se passe quelque chose qui donne confiance et permet de
continuer. J'étais extrêmement timorée et les rares fois où j'ai essayé, j'ai
essuyé des échecs cuisants. En ne connaissant pas le milieu de la
publication, je faisais comme les novices, j'envoyais mes manuscrits à
Gallimard ou aux Éditions de Minuit. C'est grâce à Dana Shishmanian que j'ai
été publiée pour la première fois. François Est-ce
que ta formation – tu es agrégée de lettres – t'a aidée dans tes activités
d'écrivain ou de poète ? Dominique Je
n'en sais rien, je crois qu'elle m’a aidée presqu’à mon insu, c'est plutôt
pour la veine critique, parce que lorsqu'on a fait des études de lettres, on
a énormément approfondi certains auteurs, et par obligation, on est habitué à
avoir une vision critique de ce qu'on lit. Cela m'a permis d’apprendre à
rédiger des articles, des fiches de lecture. François Pourrais-tu
nous parler de ton expérience de critique littéraire ? Dominique En
fait, mon parti pris de critique littéraire, c'est de n'écrire que sur des
auteurs dont j'apprécie le travail. Si je n'aime pas ou si parfois j'aime
mais je n'arrive pas à écrire, je ne le fais pas. Je n'ai jamais envie
d'écrire contre la personne qui a écrit, c'est presque une position éthique
de ma part. Pour
moi, toute critique négative est perte de temps. Je ne suis pas non plus dans
la flatterie ni dans la louange. De même, je ne suis pas dans la démarche de
savoir qui est la personne qui écrit. Comme je travaille souvent dans
l’urgence, je n’ai pas le temps de m’intéresser à la dimension biographique
de l’œuvre, je fais sans elle, je me jette dans l’écriture critique en
quelque sorte sans filet ! François Et
pourtant, tu vas loin dans tes critiques. Dominique Que
j’écrive un poème, une nouvelle, une critique, c’est de l’écriture un point
c’est tout. Parfois d’ailleurs, je fais des critiques sous forme de poèmes… Je
suis plongée à un niveau assez lointain en moi. L'écriture d'une critique
n'est pas un travail inférieur. Dans l’idéal, elle est aussi travail
poétique. Et
comme pour les poèmes, très vite après avoir écrit une note critique, le
phénomène est le même, je ne me souviens plus de l'œuvre que j'ai pourtant
lue avec une très grande attention, ni de ce que j'ai écrit. Pour moi, ce ne
sont pas deux choses différentes, c'est la même démarche, c'est la même
intensité et le plus souvent c’est le même oubli, bien que des souvenirs, à
l’état de traces, demeurent. C’est
un peu ma manière à moi d’écrire une pseudo autobiographie car choisir pour
qui on écrit n’est pas anodin et touche au personnel, à l’intime. François C’est
ce qui s’est passé pour toi quand tu as écrit toute une série d’articles sur
Henri Michaux ? Dominique C'est
exactement pareil. Je n’ai pas beaucoup fouillé dans la biographie de Henri
Michaux, même si grâce à la Pléiade, j’y avais facilement accès. J'ai écrit
des séries d'articles sur le premier tome de la Pléiade et j'ai suivi les
textes chronologiquement et chaque fois ça a été la même immersion totale
dans le texte, j'oubliais tous les autres, c'était comme si rien n'existait
plus que le texte en question. François Tu
vas au cœur du texte ? Dominique Je
ne sais pas si c'est au cœur, mais si c'est au cœur tant mieux. Ça nécessite
une grande concentration, d'autant que je ne fais pas de hiérarchie dans ce
que j'écris. François Ce
que je perçois c'est que tu prends le temps d'entrer dans l'univers
littéraire de l'auteur. Dominique C'est
la seule chose qui m'intéresse. Si je m’arrête au seuil du texte sans pouvoir
y pénétrer, je ne peux écrire sur le poète ou l’écrivain. François Actuellement,
tu participes à plusieurs revues. Dominique Essentiellement
à Francopolis, mais je participe également à la revue Voix et
très récemment à la revue Poésie/Première. À cette occasion, vous
lirez dans le dernier numéro un article sur Francis Ponge (La fabrique du
pré). François Pourrais-tu
nous parler des livres que tu as publiés ? Dominique - Fissures d'été (2014)
raconte en filigrane en 150 haïkus une histoire d'amour. « En
chemin » est le deuxième volet du recueil et n’est qu’un long poème fait
de courtes strophes. Quant à la troisième partie « Passe-Temps »,
ce sont de nouveau des haïkus (49) qui sont des sortes de vœux pour la
nouvelle année. -
Les feuillets d'obsidienne (2015).
Ce recueil est particulier car lié à la maladie de
mon compagnon d’alors. À partir du moment où on a su qu'il était très malade,
j'ai commencé à écrire la première partie Quand bien même ! Cette
plongée sporadique dans l’écriture m'a aidé à supporter cette période très
difficile. La
deuxième partie Les feuillets d'Obsidienne correspond au moment où on
apprend la récidive du cancer. Cette annonce coïncide avec l'accident
nucléaire de Fukushima. Ce malheur intime et ce malheur beaucoup plus vaste
se confondent dans la mesure où les deux agissaient de façon sournoise. J'ai
écrit la troisième partie Déni de rêve après la mort de mon compagnon.
Elle correspond à des moments où je faisais des rêves dans lesquels il
apparaissait. J'étais dans un déni de sa mort puisqu'il apparaissait dans mes
rêves. C'est en grande partie pour cela qu'il y a des allusions aux dés, au
hasard. Il y a même des poèmes où il est question de mauvais sort. Ça m'a aidé à supporter le deuil et à vivre
peu à peu sereinement. -L'intimité
de l'air (2018)
est un recueil un peu spécial constitué de quintils. En fait, j'ai voulu
apprendre ce qu'étaient les cinqkus. J'ai appris à
les faire. Je me suis exercée pendant des mois. Je les ai regroupés par thème
(la langue, l'attente, le jazz...). Je ne sais pas si j'ai réussi mais il me
semble que la poésie tend à allier de façon énigmatique la légèreté à la
gravité... Parallèlement à ces quintils, j'ai appris à nager le crawl ce même
été. Le lien : le bonheur d’apprendre quelque chose de nouveau, de m’en
sentir encore capable ! En tout cas dans mon esprit les deux
apprentissages sont liés à jamais. -
Pour saluer Apollinaire (2019) ce sont dix nouvelles, surtout
liées à Alcools. Comment expliquer ? À chaque nouvelle correspond
un « traitement » d’un ou plusieurs poèmes d’Apollinaire. Dans
« Je dis nécessité » par exemple, j’incite le lecteur à lire
« Nuit rhénane » puisque je donne le dernier vers du poème à la fin
de la nouvelle, mais qu’en fait presque tous les mots du poème sont éclatés à
l’intérieur du texte comme si le verre s’était déjà brisé. Les reprises
lexicales du poème dans la nouvelle devraient alerter le lecteur. François Pour
le lecteur, c'est un peu un jeu de piste ? Dominique Ce
sont des nouvelles à contraintes. Certains poèmes m’ont marquée à vie :
tel est le cas pour Les colchiques que j’ai étudié en 6ème
avec Mlle Moreau, notre professeur de Français qui a tant compté pour moi et
a sans doute été à l’origine de mon désir d’enseigner, d’écrire et de
chercher le ou les sens d’un texte. C’est
vrai que la lecture d'Apollinaire vient de loin. Je suis comme un personnage
d'une des nouvelles qui se récite des poèmes d'Apollinaire, dans certaines
circonstances de tristesse, en automne, en marchant... Apollinaire intervient
donc dans chaque nouvelle parfois de façon floue, parfois de façon massive
comme dans Fugue. J’ai construit cette nouvelle à partir du poème
« chantre » et de son monostiche « Et
l’unique cordeau des trompettes marines » qui, chaque fois qu’il
apparaît est imprimé en rouge. Ce récit est une véritable plongée dans
quelque chose de mystérieux où je convoque plusieurs autres poèmes d’Alcools. -Des
Nuances et des jours (2020) est un recueil qui se déroule de la fin
d’un été à la fin d’un hiver. Chaque jour recèle une saveur, une humeur, une
joie ou de la tristesse. On y repère des expositions, des rêveries, des
balades, un voyage. Les jours ordinaires laissent place, parfois, à des jours
où des événements dramatiques ont eu lieu et qui parlent à chacun de nous.
L’intime se mêle donc à la grande histoire. -Quand
dans l'expectative (2020).
Pendant le premier confinement, nous avons Agnès Adda et moi écrit
pratiquement chaque jour des poèmes. Nous avions des conversations
téléphoniques assez fréquemment. Quand le confinement serait terminé, on
s'était promis d'échanger nos poèmes. On s'est ensuite dit qu'on pourrait les
regrouper et pourquoi pas en faire un recueil. Les deux parties du recueil
sont séparées et sont des chroniques couvrant la période du confinement. Ce
sont deux univers très différents qui mettent en scène la solitude,
l’angoisse, l’impatience et la Seine qui nous relie. La troisième partie est
une confrontation à deux voix sur l'écriture poétique. François -Sans
nom le ciel (2021) est
un recueil que tu as fait avec Pierre, ton frère peintre. Peux-tu nous dire
ce qui a motivé ce choix de faire cet ouvrage avec ton frère ? Dominique Ce
qui est antérieur, ce sont les expositions de mon frère sur les migrants, les
réfugiés, bien avant que j'écrive sur ce thème. Il avait notamment fait une
expo absolument magnifique sur les naufragés de la vie. Toutes sortes de
naufragés de la vie, y compris notre père atteint d'une maladie dégénérative
mais il y avait surtout des tableaux sur les migrants et particulièrement un
tableau représentant un homme qu'on voit avec une chemise blanche et des
valises dignes de Charlie Chaplin. Cet homme semble s'avancer vers nous... Le
thème commun de Sans nom le ciel, c'est la fraternité au sens large du
terme et le tissage entre les tableaux de mon frère et les textes que j'ai
écrits. L'exergue de Patrick Chamoiseau tiré de Frères migrants,
témoigne de ce désir de fraternité. François Merci
Dominique. Quelque chose me dit que les lecteurs de Francopolis qui ne te
connaissent pas encore auront envie de découvrir ton univers poétique. Dominique J’en
serai ravie. Merci François. |
|
Dominique Zinenberg - en entretien avec François Minod
Francopolis
– Novembre-Décembre 2021 |
Créé le 1 mars 2002