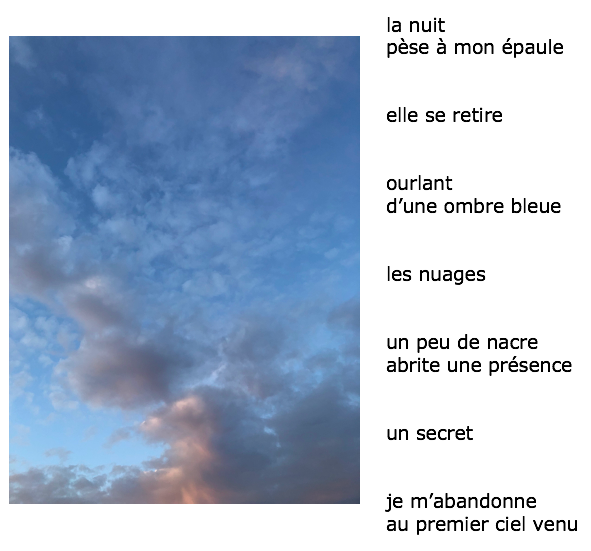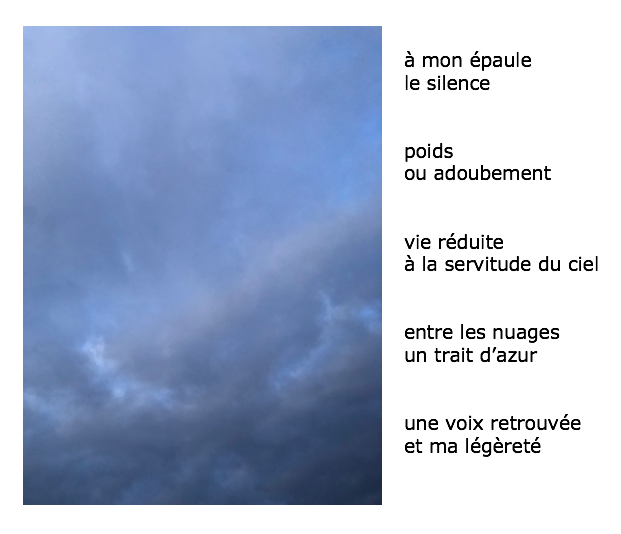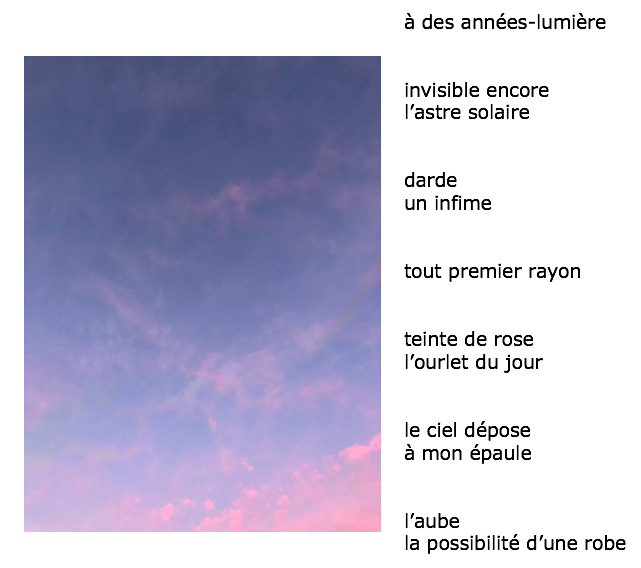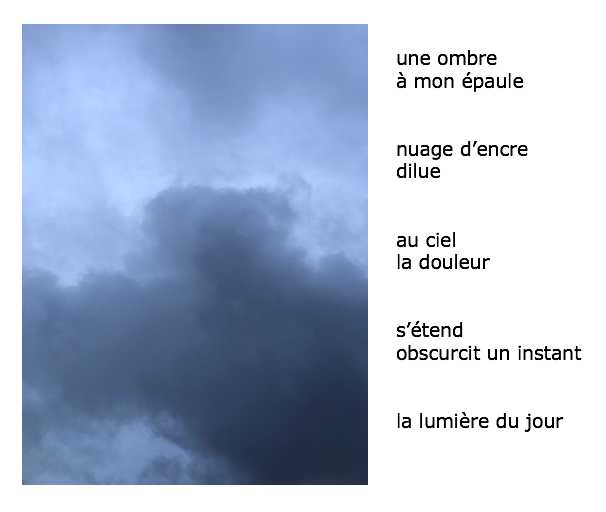|
Le Salon de lecture Découverte
d'auteurs au hasard de nos rencontres |
*** |
|
SALON DE LECTURE Printemps 2025 Ida Jaroschek : « Attentive,
éperdument ». Entretien et poèmes (*) |
|
|
ENTRETIEN (février 2025) Ida,
j’ai découvert ta poésie dans ton recueil « À mains nues », publié
en 2022 chez Alcyone (cf la chronique
parue dans Francopolis). La nature est très présente dans ces
textes, une nature exubérante, à la fois âme et corps, horizon et sang,
caresse et brûlure. Le paysage s’y fait extension du corps, quand tu écris
par exemple : « Poussière des tournoiements /
une danse // à dévaler le chatoiement des pentes / de mes jambes
torrentielles, sinueuses, embrasées ». Il y a dans ta poésie beaucoup de
sensualité, de tendresse, et en même temps un souci permanent d’atteindre l’âme,
toucher l’être au plus près, l’amour toujours au cœur. Pour te poser une
question que j’affectionne : Écris-tu pour aimer ? Plus largement,
d’où est né ton désir d’écrire de la poésie ? Quelles en sont les
motivations profondes ? Tout d’abord,
je voudrais te remercier pour l’attention si intelligente et si sensible que
tu portes à mes poèmes et remercier également la revue Francopolis de
m’offrir cet espace de rencontre avec ses lecteurs. Oui, c’est vrai
la nature est très présente dans mes textes et plus spécifiquement le
paysage. J’ajouterais à ta citation celle-ci, extraite elle aussi de mon
recueil « À mains nues ». Au tout début, dans le deuxième poème,
j’annonce la couleur, si je puis dire : « Je suis
la séparée, la traversante Corps illimité
au prolongement des paysages » Il y a certes des
steppes, la forêt, la rivière, le fleuve, la colline, la mer, la montagne, le
ciel dans mes poèmes mais ils existent plus comme des archétypes et comme des
pierres d’achoppement pour soutenir un monde imaginaire plutôt que comme des
entités réelles. De même pour les végétaux : l’arbre, la rose. Et dans
mon bestiaire : l’oiseau de nuit, le héron cendré, l’hirondelle, le
cheval et les grands fauves que l’on croise à plusieurs reprises et qui sont
comme des figures tutélaires issues de mes rêves, des animaux totémiques,
mythologiques en quelque sorte, d’une mythologie qui me serait propre. Il faut dire
que je suis née à la campagne, que je fus, durant quelques années, citadine
mais que j’ai, jusqu’à présent, passé le plus clair de ma vie à la
campagne : en Normandie d’abord dans le bocage et près des grandes
forêts domaniales de l’Orne et désormais, depuis de nombreuses années déjà,
ici en Languedoc dans la belle région du Pic St Loup entre vignes et
collines. Ainsi, je me
définis souvent comme une poète-promeneuse qui soulève sur les chemins
« les pas lents du poème » pour reprendre le titre de mon prochain
recueil. D’où la présence des paysages dans ma poésie, paysages qui
alimentent ma nature contemplative. Mais pas seulement, comme le laisse
supposer le vers que j’ai choisi, car j’ai aussi la tentation de disparaître
aux paysages, et pour cela d’agrandir mon corps, c’est à dire d’élargir mes
perceptions, mes sensations que la parole poétique tentera de laisser émerger
pour les partager. Ainsi c’est
bien le corps qui est le médium, qui est l’extension du paysage comme tu le
dis très bien ou, comme je viens de le formuler, qui tente de prendre les
dimensions du paysage. Le corps, d’où
cette sensualité que tu évoques. Le poète Jean-Louis Clarac
dit très justement de ma poésie : « Sa
poésie est toute entière mouvement. Pour elle, écrire est la mise en forme
des traces que le corps dessine dans l’espace du monde, le corps expression
poétique de soi et des autres, au contact de la nature, des éléments, des
paysages… ». Je crois qu’on
ne saurait mieux dire : le corps dans sa sensualité et aussi dans son
mouvement qui se confond avec celui de la vie. Il s’agit d’avancer, d’aller,
de marcher et de danser sa vie. Poète promeneuse et danseuse. D’autre part,
je pense être une poète à motif, tout comme on dit d’un peintre qu’il a un
motif. Je n’ai pas comme Cézanne un seul motif, mais plusieurs. Mes motifs
sont des mots : neige, bleu, rouge, jaune, ombre, robe, lumière, le
baiser, visage, nuit, danse… « Les grands fauves » et
« corps » déjà évoqués pour leur nature archétypale, s’ajoutent en
tant que mots à cette liste. J’en oublie sans doute quelques autres. Mes
poèmes se développent comme des variations ; quelquefois, même, un mot
ou un motif ricoche d’un poème dans l’autre. Puisque nous
évoquons le corps et la sensualité, nous abordons le territoire de l’amour.
L’amour charnel mais pas que. Tu parles de
tendresse, je ne sais pas où la percevoir dans mes poèmes. Peut-être
simplement ne me suis-je pas posé la question. Tu dis tendresse, je dirais
plutôt érotisme, un érotisme qui avance plus ou moins masqué mais qui irrigue
souvent mes poèmes. Car j’écris des poèmes d’amour. Comme pour beaucoup
d’entre nous, enfin je l’espère, l’amour est la grande aventure de ma
vie. Au-delà de
l’érotisme, de la romance ou de l’aventure amoureuse tu me demandes si
j’écris par amour. Je ne saurais pas répondre directement à cette
question. Mais je veux
citer les paroles de Pierre Michon que l’on interrogeait au cours d’un
entretien concernant son dernier récit paru récemment aux éditions Gallimard
et qui s’intitule : « J’écris l’Iliade ». Augustin Trapenard lui demandait le pourquoi de ce projet de
récrire l’Iliade, à quoi il a répondu : « Parce que l’Iliade
contient le scénario de toute la littérature européenne et même de l’humanité
qui se résume aux deux composantes que sont l’amour et la guerre ». Si l’on entend
l’amour dans cette acception plus large, il est vrai que je me situe plus du
côté de l’amour que de la guerre, que je m’inspire plus de l’amour que de la
guerre. L’amour est un
geste vers l’autre, le poème est bien une main tendue qui ne demande qu’à
être prise. « Je ne vois pas de différence entre une poignée de mains et
un poème » dit Paul Celan. Alors, pour répondre à ta question :
oui, j’écris dans un geste d’amour. Tu me demandes
d’où vient mon désir d’écrire de la poésie et quelles sont mes motivations
profondes. C’est une très
vaste question, si je devais y répondre simplement, je dirais que je n’ai pas
choisi la poésie, que c’est elle qui m’a choisie. Je pourrais
dire aussi que je n’ai pas d’autre choix que de le faire. Je ne sais pas
vivre autrement. Pour expliciter
un peu les choses, la poésie est entrée dans ma vie comme une épiphanie sur
les bancs de l’école quand j’avais neuf ans. Depuis, elle ne m’a pas
quittée. Pour moi lire
et écrire des poèmes sont les deux versants d’une même activité et,
personnellement, je passe plus de temps à lire des poèmes qu’à en écrire. Plus tard, dans
ma vie d’adulte, l’écriture s’est imposée à un moment où elle a représenté
les conditions mêmes de ma survie. À l’âge de neuf
ans, mon instituteur de la classe de CM1 étant absent, un jeune remplaçant
est venu faire classe à sa place. Il ne nous a pas demandé, comme à
l’accoutumée, de recopier dans notre cahier le poème qu’il aurait écrit au
tableau. Non, il a commencé par lire un poème. Et j’ai entendu :
« L’adieu J’ai cueilli ce brin de bruyère L’automne est morte souviens-t-en Nous ne nous verrons plus sur terre Odeur du temps brin de bruyère Et souviens-toi que je t’attends. » J’ai été saisie.
J’ai compris que plus rien ne serait comme avant, que mon regard sur le monde
ne serait plus jamais le même ou plutôt que le monde se montrait à moi sous
un jour nouveau dans sa vérité, dans sa beauté, dans sa clarté. Tout
s’éclairait. J’ai eu le sentiment que ma vraie vie commençait là, à cet
instant. Dès le
lendemain, toujours Apollinaire et son automne malade, puis quelques jours
après : « Demain
dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai Vois-tu, je sais
que tu m’attends (…) » Je crois que le
mot « aube » ne faisait pas encore partie de mon vocabulaire, que
je ne saisissais pas vraiment quel était l’objet de cette attente, d’un poème
à l’autre, et dont je sentais qu’il s’agissait d’une attente identique sans
vraiment comprendre que cette attente même séparait tout en le réunissant le
monde des vivants et celui des morts. Pourtant tout était d’une clarté
limpide. Et tout me paraissait tellement vrai et tellement juste. De même je
n’avais pas idée que l’épervier qui planait au fond du ciel fût un oiseau. Je
croyais que c’était un animal cousin du loup dont on criait le nom dans la
cour de récréation en jouant : « Éperviers, sortez ! ». Quant aux
« nixesnicettezauxcheveuxvertzetnaines »,
que j’entendais comme un seul mot, je ne savais pas du tout qui elles étaient
ni pourquoi elles n’avaient jamais parlé, ni par quel mystère leurs cheveux
étaient verts. Mais tout cela exerçait sur moi un charme profond. J’étais
sidérée. Bouche bée. Je ne
comprenais rien et je comprenais tout. Le monde se révélait à moi dans sa
complexité, dans son mystère et dans son évidence. C’est bien
comme ça que la poésie m’est apparue comme un mystère et comme une évidence
et c’est comme ça que je la perçois et que je le vis encore aujourd’hui. Dans
cette « oscillation paradoxale » dirait mon amie chorégraphe
Jacquie Taffanel. Pour moi, le
poème, dans cette oscillation, se place entre le mystère et l’évidence, entre
le silence et la parole qui vient le combler, entre l’indicible et sa
saisie. Il commence
quand je n’ai plus rien à dire, ou quand je ne sais plus dire ou pas dire
quand quelque chose de la vie, ou d’une émotion se dérobe. Le poème tenterait
de venir résoudre cette énigme d’un sens qui échappe et qui ne peut se dire
ni se fixer. Un peu comme un kōan dans la
tradition bouddhiste. Le poème est une tentative pour approcher l’indicible.
Énigmatique, il n’apporte pas vraiment de résolution puisqu’il doit rester
ouvert à tous vents, ouvert à celui qui s’en saisira et qui devra se frayer
un chemin dans la multiplicité du sens. Le poème ne dit rien. Il est. Il fait
silence autour de lui. De sorte que chacun se parle en son for intérieur un
langage sensible qui réinvente le monde. Je ne suis pas
sûre d’avoir répondu à ta question sur mes motivations profondes car je ne
crois pas les connaître. Mais ce que je viens d’énoncer là, je l’éprouve et
j’y crois. Mais si, tu y
as répondu ! Un désir d’embrasser la vie je crois, en toucher la part
d’éternité. Le poème, dis-tu, commence là où la raison ne trouve plus les
mots, il ne s’agit plus de dire, mais de s’éveiller, être dans l’instant
d’éveil, pareil à cet enfant, « bouche bée » devant l’inexplicable,
et qui réinvente le monde. Tu étais, tu es toujours, me semble-t-il et pour
reprendre les mots d’Éluard, « comme un enfant devant le feu ».
L’écriture chez toi est émerveillement. En témoignent ces poèmes de ton « Carnet
de ciel », que tu es en train d’écrire depuis ta chambre de
convalescence après une opération de l’épaule, le ciel dans la fenêtre pour
unique inspirateur. Poèmes épurés et verticaux, assez différents dans la
forme de ceux de « À mains nues », plus proches peut-être de
« Ici soudain » que tu m’as fait lire récemment. Peux-tu nous en
dire plus ? Que reflètent ces différentes formes d’écriture ? Que
traduisent-elles de ton approche de la poésie, et à travers la poésie de la
vie elle-même, puisque, me dis-tu, tu ne sais pas vivre autrement que par la
poésie ? Je vois que, comme moi, tu as recours à des citations pour préciser ta
pensée. Je partage avec toi cette façon parfois de convoquer les mots des
poètes pour m’aider à penser (et pas du tout dans le souci de paraître une
personne cultivée). Aussi, quand tu dis que l’écriture pour moi est émerveillement, pour
compléter cette assertion, me vient tout de suite à l’esprit le titre d’un
livre d’entretiens avec, entre autres, Christian Bobin
et Charles Juliet paru aux éditions Paroles d’aune. Ce titre
est : » La merveille et
l’obscur ». Je reviens ainsi à cette « oscillation paradoxale » entre deux
contraires. La contemplation du monde ou le retour sur soi, ce mouvement
d’aller et retour que propose l’écriture entre le dehors et le dedans - car
c’est bien ce mouvement de trouver au paysage l’écho de mon intériorité qui
fait naître en moi le poème - ne suscite pas seulement l’émerveillement mais
parfois aussi l’effroi. Le feu est parfois sous la glace, le lac sous la
montagne, les flammes sous le vent, le ciel sous la terre. « Et nous marchons en ce monde sur les toits de l’enfer en regardant
les fleurs », je cite cette fois Issa ce grand poète japonais du XVIIIe
siècle. Si ma poésie traduit la joie que j’éprouve et cultive, elle n’en
n’exprime pas moins, je crois, une grande douleur. Douleur qui, peut-être,
comme je le disais à l’instant de l’érotisme, avance elle aussi plus ou moins
masquée. Je voudrais continuer avec ce jeu des citations pour compléter et nuancer
ce que tu dis quand tu parles d’éveil. Je me trompe peut-être mais j’entends
là un mot qui serait dans le registre de la spiritualité ou même du
mysticisme. Je me contenterais de dire plus modestement, avec mon cher ami
poète Gaston Marty qui nous a hélas quitté récemment, et que je n’oublie
pas : je suis par moments attentive
éperdument ; » Attentif éperdument » étant le titre de
son dernier recueil et les derniers mots de la dernière lettre qu’il
m’envoya. Les titres choisis par les poètes méritent notre attention car parfois
ils révèlent quelque chose comme une mise en abîme de l’écriture ou comme une
profession de foi. Je pense également à ce titre d’Israel
Eliraz et qui relève lui aussi d’une certaine
oscillation paradoxale : « Entrer dans la chambre où l’on est
depuis toujours ». De même, je
peux m’amuser à sillonner entre les titres de mes propres recueils et dire
que j’écris « à mains nues » pour me tenir « à l’abri
dans les nuits » ou sur « la brèche de l’air » afin
d’« aborder les lointains » et d’atteindre « la survivance de
la neige ». Que la parole poétique surgit « ici soudain »
quand je marche inlassablement ou que je danse pour soulever « les pas
lents du poème ». Que « l’espace d’un souffle », tout oscille
entre « tango et naufrage ». Tu évoques ce
travail en cours qui a pour titre « Carnet de ciel ». Les lecteurs
méritent quelques éclaircissements. Je séjourne actuellement en clinique de
rééducation pour de longues semaines et je m’adonne à un rituel matinal.
Depuis le balcon de ma chambre, je prends chaque matin une photo du ciel. Je
ne choisis pas la prise de vue. Il n’y a qu’un seul endroit et un seul angle
possible pour ne photographier que le ciel sans qu’aucun bâtiment ou aucun
élément du décor urbain n’entre dans le cadre. C’est un ciel donné. Je
l’accompagne d’un court poème vertical et je l’envoie à mes amis à titre de
bulletin de santé ou de ciel d’humeur. Il s’agit juste de lire dans le ciel
mon état d’âme. Nous sommes
bien dans ce mouvement que j’évoquais plus haut qui consiste à me saisir du
paysage pour ouvrir un espace intérieur de rêverie, de pensées. Un espace qui
soit suffisamment ouvert pour que le lecteur ait la même latitude, à partir
de quelques mots, pour élaborer lui-même en écho son propre univers de
pensée, de rêverie ou d’imagination. En cela
s’illustre également ma manière de faire, exposée dans ma réponse à ta
première question : le ciel vaut pour sa présence en tant que figure et
le motif qui revient dans chaque poème est l’expression : « à mon
épaule ». Oui, tu as
raison : ce petit ensemble est de même facture que « ici
soudain », et que « à l’abri dans les nuits » et
« aborder les lointains ». Ce sont des recueils qui sont composés
de poèmes de format identique : des formes brèves verticales. Ce sont
des poèmes qui procèdent de l’ellipse, où les mots sont travaillés un à un,
avec un désir de simplification syntaxique à l’extrême. Ce sont des poèmes
environnés de silence, qui sont tout en suggestion. C’est ce que j’appelle
mon exigence du peu. Cette volonté aussi d’éloigner le langage poétique le
plus possible du langage courant. Il s’agit de raréfier les choses,
d’élaguer, d’épurer, de dire sinon l’essentiel, du moins le peu. Il m’est
arrivé de dire que cet art poétique relevait d’une esthétique des clairières… Mon écriture
poétique se décline sur deux versants : d’un côté, donc, ces formes
brèves, verticales et de l’autre des poèmes qui obéissent tous aussi à la
même forme car ils sont composés de distiques parmi lesquels se glissent un
ou plusieurs vers simples qui viennent ainsi se démarquer. Ce sont des
poèmes à motif eux aussi, mais qui déroulent des images et acceptent
d’épouser une syntaxe qui parfois est sciemment ambiguë et qui n’enferment
pas les vers dans des phrases ; ou bien dont les phrases restent
ouvertes, pourrait-on dire, avec une présence des majuscules qui ne
correspond pas à l’usage commun et introduit parfois le doute de savoir si un
groupe de mot peut être à la fois, par exemple, le complément d’objet d’un
verbe et le sujet du distique suivant, d’où cette ambiguïté assumée pour
brouiller le sens, le laisser ouvert, une fois de plus. Ne pas soumettre le
sens à une syntaxe ou à une logique de phrases. « Survivance de la
neige », « À mains nues » et « Les pas lents du
poème » (à paraître) sont sur ce versant-là. Ce qui m’amène
à préciser l’importance de la notion de forme dans mon écriture. La poésie
contemporaine s’est affranchie des règles de la prosodie classique. Mais j'ai
besoin d’une forme pour y loger mon poème. J’ai besoin d’inventer des règles
prosodiques qui me soient propres et dont je viens d’expliciter
quelques-unes. D’autres sont là, peut-être moins visibles. Ce qu’il y a de
tout à fait particulier, miraculeux - oserais-je même dire -, c’est que
cela ne procède pas d’une intention délibérée, n’est pas le fruit de ma
volonté. Cela peut paraître étrange mais ces deux formes se sont imposées à
moi. Je les reconnais. Je peux les décrire. Mais je ne les ai pas choisies.
Peut-être viennent-elles d’un rythme intérieur, d’un phrasé caché, toujours
le même, et qui a trouvé ces deux formes pour s’incarner. C’est
précisément cette douleur, dont tu dis qu’elle avance masquée, qui donne à ta
poésie, au plus haut de sa joie, toute sa vérité, tout son poids de vie et
d’humanité. J’avais écrit dans ma chronique de « À mains
nues » : « Déchirement et fusion constituent les
termes de cette poésie criant en un même souffle douleur et joie »,
exprimant très précisément chez toi cette dualité fondatrice.
« Attentive, éperdument », c’est le titre, si tu es d’accord, que
j’aimerais donner à l’ensemble de cette contribution, car il me semble
pleinement caractériser ta démarche, ce don sans retenue que tu fais dans tes
poèmes de ton attention au monde et à l’autre. Une dernière question si tu
veux bien. Tu m’as dit, juste après ton opération, te réciter intérieurement,
pour faire face à la douleur physique, de nombreux poèmes, poèmes que tu
connais donc par cœur. Pourquoi et en quelle occasion mémorises-tu des
poèmes ? Y cherches-tu une voix intérieure, capable de te soulager des
maux de la vie, ou bien s’agit-il d’autre chose ? Peux-tu nous en dire
davantage sur les poèmes et les poètes qui te parlent le plus, t’habitent le
plus ? Je vois
effectivement que tu m’as bien lue et je t’en remercie encore une fois. Comme je l’ai
dit précédemment, écrire des poèmes et lire de la poésie sont les deux
versants d’une même chose qui est devenue centrale dans ma vie. Et je passe
plus de temps dans la fréquentation des poètes qu’à écrire moi-même. Dans certaines
circonstances, dont celle à laquelle tu fais allusion, quand mes livres ne
sont pas à portée de mains, je cherche les poèmes qui sont inscrits dans ma
mémoire. Car je ne peux pas me passer de poésie un seul jour, une seule
nuit. Certains poèmes
sont inscrits dans ma mémoire depuis l’enfance ou l’adolescence, tous les
poèmes appris à l’école, au collège, au lycée sont là, intacts. Ils sont pour
la plupart des monuments de la littérature comparables au Taj Mahal, au
château de Versailles, à Notre Dame ou à la Tour Eiffel, des poèmes écrits
dans le marbre en lettres d’or ; notre patrimoine qui ne risque pas
d’être en péril, ni de s’écrouler ou de succomber sous les flammes, tant que
nous les lirons, les mémoriserons, les partagerons. Parmi eux, figurent des
poèmes de Villon, Ronsard, Hugo, Baudelaire, Rimbaud (que je place tous deux
très très haut), Verlaine, Apollinaire. Mais aussi
des vers de Racine, de Corneille, de Molière, tout ce que l’institution
scolaire m’a transmis. Il m’a fallu
attendre de quitter mon village, et d’être pensionnaire au lycée, pour entrer
pour la première fois dans une librairie à l’occasion de la sortie autorisée
du jeudi. C’est comme si j’entrais dans la caverne d’Ali Baba. Je me suis
dirigée droit vers le rayon de poésie qui consistait en une seule étagère de
petits livres blancs bien alignés où, sur la tranche le nom d’un poète et le
titre du recueil s’écrivaient de part et d’autre d’un petit rectangle coloré
sur lequel apparaissait un visage. Vous aurez reconnu la petite collection
blanche Gallimard. C’est ainsi que le hasard, dicté par les choix de l’unique
libraire de la petite ville d’Alençon, a mis entre mes mains « Capitale
de la douleur » de Paul Éluard. Deuxième choc. « L’amoureuse Elle est debout
sur mes paupières Et ses cheveux
sont dans les miens (…) » Mais
l’amoureuse, c’était moi ! À quinze ans, l’amour était déjà la grande
affaire de ma vie ! « La courbe de tes yeux fait le tour de mon
cœur » ou ce que tu as toi-même cité : « Je suis devant
ce paysage féminin comme un enfant devant le feu », « L’aube je
t’aime, j’ai toute la nuit dans les veines » etc.. etc.. tout
m’enchantait ! Coup de foudre pour Éluard ! Suivront,
venant de la même étagère, Breton, Desnos, Aragon, Artaud… qui m’ont marquée
durablement. Éluard a été le
poète de ma jeunesse. Je recopiais ses poèmes dans des carnets, dans des
lettres. Un certain nombre se sont gravés dans ma mémoire sans que je fasse
l’effort de les apprendre. Par la suite,
et en avançant dans la chronologie, j’ai pour compagnons les grands poètes de
la deuxième moitié du XXe siècle : en premier lieu Jaccottet
qui creuse le sillon de l’écriture à même les paysages, Bonnefoy, Dupin,
Torreilles, Guillevic, Michaux, André Du Bouchet et son écriture épurée, puis
Bernard Noël et Lorand Gaspar qui m’est très cher,
l’immense Paul Celan, Ingeborg Bachman et tant
d’autres… La pratique du taï chi chuan et mon intérêt pour la pensée taoïste m’ont
ouvert également le champ de la poésie chinoise et de la poésie japonaise
avec les grands maîtres du haïku Basho Issa, plus
proche de nous Soseki. Haïkus dont j’ai pratiqué
l’écriture avant d’adopter mes formes brèves verticales et qui m’ont
influencée pour sacrifier à cette exigence du peu qui fut pour un temps mon
credo. Quand je me
suis rapprochée des rives de la Méditerranée, c’est tout un autre domaine que
j’ai exploré avec bonheur : Edmond Jabès, Adonis, Mahmoud Darwich, Salah Stétié, Israël Eliraz, Mohamed Bennis, Venus
Khoury Ghata, Andrée Chedid… Je chemine
également avec mes contemporains en premier lieu les amis montpelliérains
dont je suis de près le travail, comme James Sacré, Patricio Sanchez et deux
femmes poètes auxquelles je voue une grande admiration et qui, à mon sens,
seront des voix qui compteront : Régine Foloppe
et Gaëlle Fonlupt. Je me sens proche parfois de la
poésie de Dominique Sampiero. Dans les contemporains, je voudrais citer, dans
un tout autre registre, le poète Baptiste Pizzinat
dont la parole poétique, dans sa radicalité, me semble indispensable en ce
moment. Je ne peux pas
ne pas citer Rilke, Lorca, Neruda, Vallente, Alejandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Eugénie de Andrade, Antonio Ramos Rosa et
j’aimerais en citer tant et tant d’autres. Tout un océan de lectures… Les poètes
m’accompagnent ; ils m’aident à vivre, à nourrir mon intériorité, à
façonner et élargir mon regard sur le monde. Ils me sont si indispensables.
Pour moi, lire des poèmes est plus essentiel encore qu’en écrire. Je suis
lucide : mes poèmes n’atteindront jamais ni le Taj Mahal, ni le
Fuji Yama, ni le Kilimandjaro, ni même la Tour Eiffel !
J’écris modestement à hauteur d’Hortus et de
Pic St Loup. Pour prendre de l’altitude et voir un peu plus au-delà de
moi-même, heureusement il y a les poètes ! Je ne sais pas
si la poésie peut changer le monde, le monde tel qu’il va (si mal !
perpétuant la barbarie, prônant des valeurs triomphantes de force et de
brutalité, détruisant tant de manifestations du vivant et menaçant très
gravement les conditions mêmes de la survie de l’humanité). C’est pour
réfléchir à cette question-là qu’il faut lire Baptiste Pizzinat
qui nous met bien les points sur les i, sur tous nos i… Si la poésie ne
pouvait pas changer le monde, elle peut me changer moi. Et si je continue
d’écrire mes petites chozzzzzz c’est pour survivre
moi-même, mais aussi pour les lire et les échanger avec les poètes d’ici et
les amateurs de poésie alentour pour tisser des liens d’amitié, de sororité,
de fraternité. Exactement de
la même façon je danse au sein de la compagnie amateure de danse
contemporaine Lili&ken co-fondée il y a une
bonne vingtaine d’années avec des amies danseuses. Écrire,
danser : une manière de rester debout malgré tout, reliée aux autres, à
quelques autres du moins… Je finirai par
ces quelques mots extraits de « Survivance des lucioles » de
Georges Didi Huberman : « Nous
devons donc nous-mêmes - en retrait du règne et de la gloire - dans la brèche
ouverte entre le passé et le futur, devenir des lucioles et reformer par là
une communauté de désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré
tout, de pensées à transmettre » Survivance des
Lucioles Éditions de
Minuit (2009) *** POÈMES Je suis
la séparée, la traversante corps
illimité au prolongement des paysages au long
des crêtes, des failles nos
brèches, des horizons Je
n’oublie pas tout ce
noir entré dans ta bouche et
l’orée d’une route elle va,
rejoint ma peau
à l’étendue * Poussière des
tournoiements une danse à dévaler le chatoiement des pentes de mes jambes torrentielles, sinueuses, embrasées Dans l’emballement du corps, son chant les gestes du silence où reposent les mots mots comme pépites, étincelles à toucher votre regard Le bleu jusqu’à l’inachèvement * Chevauchant
d’un sourire les grands fauves tu vas,
respires redonnes
à l’amandier son
poumon Tu te
défais des nacres, des duvets des
onctuosités tu
rejoins l’abrupt et les failles les pierres des
roches imprimées de mémoire, du passage des eaux et les
tunnels sous les buis l’attente
est une promesse un pont,
saveur de langues pour
soutenir l’haleine d’un très long baiser sans
mesure un si
long baiser * Livrées au soir, les roses prennent aux femmes leur visage Je vois l’extase précipitée
de vos doigts L’exil de la lumière,
ses rythmes Ils domptent le chant
des sirènes pour déciller votre
peine et déployer dans
l’air mon geste Extraire de l’œil du
cheval l’intempérance, les algarades du
vent, la semence des ombres * À l’affût des ombres dans le soyeux, dans
l’énigme des pétales de rose
au bout de vos doigts J’invoque pour vous
le réveil des abeilles l’oscillation du
vent, le péril des fleurs Je vois votre
silhouette dans le grain de la lumière mes mots en filigrane
de ciel Quand tout vacille et
que fluctue la langue ses élans, ses
éclats, des débris des scories
incrustées au cœur même du désir dans le flux d’un
secret * Votre main poursuit
l’encrage de mes seins au paysage de soleil en sommeil
jour caviardé tandis qu’à la
lisière de ma robe un peu de peau se
découvre elle entraîne les ombres sauvages,
les orchidées au péril des fleurs,
votre cœur quand le désir aura
mangé votre visage roses de nuit
envoyées dans l’affolement des
satins, les replis de l’impensé * J’ai vu la mort de
près, elle avait ses chevaux Le vent dans les
graminées déjà m’emportait J’ai caché mon visage dans les ronces, les
griffures d’ombre l’encre des barbelés,
l’écorce des bouleaux Je m’accrochais aux
blanches déchirures neige plus nue que la
peau avec ses éclats de
rouge accrocs de robes ou
de coquelicots Revers de la mort au verso du visage,
un poème Il franchira les
fossés Jusqu’à vos mains qui
fouillent Fouillent sans cesse la
terre, la nuit, les astres * J’attends vos sentiments à
mains nues couvée de ciels,
éther, azur à peine je vous
distingue silhouette, pas et
peau de velours Des mots s’échappent
de ma robe échos de dentelle et
de fleurs des mots ourlés
d’oiseaux Dans la découpe des
ombres pourfendent l’air
jusqu’aux lointains Et les grands fauves
à nouveau entrent dans la mer * J’ai pour vous la vérité
caressante le parler cru et
fleuri du désir J’ai l’enfance en travers des
prairies, en travers des forêts Vos mains scabreuses
et délicates Touchent le ventre
fuselé, blanc des hirondelles Elles soulèvent la
nuit Une petite clarté
vient à moi, elle claudique Elle serre dans ses
bras un secret Un secret sans nom,
sans forme ni visage à peine une ombre,
volatile et sauvage Nous sommes le
souffle des oiseaux dans un cœur qui s’en
va * En bordure des braises
j’attends le chant qui ne vient pas Clôture, cicatrice sépare mon corps de son poids obscur Ombre dégrafée sein blanc glissé aux confins du paysage Je distingue votre âme ombreuse Elle approche, elle perce le ventre de la nuit Percute mes retranchements, mes velours du dedans l’enfouissement de la lumière Il reste à inventer les peaux invisibles, l’amorce du poème une danse, un feu sur la glace Pour livrer à la fin des phrases leurs vérités brûlantes * J’attends
du vent ses agissements, ses
hésitations dans l’azur qu’il me
ramène à la rive secrète et impudique où des
doigts parcourent mon sang tandis
qu’il remonte dans mes jambes la
marée, les laisses du jour, une valse Tout est
facile et lent Je reste
là, traversée de foehn en proie
à la migration des abeilles, la résolution des moiteurs Au lieu
de l’épuisement du sens ou lit
brûlant dans les dunes je
connais votre soupir, une destination Poèmes extraits de « à
mains nues », Éditions Alcyone *** * * * * * * * * Poèmes
inédits extraits de
« Carnet de ciel » ©Ida Jaroschek |
|
(*) BIOBIBLIOGRAPHIE Née en
1961, poète, lauréate de plusieurs prix de poésie, Ida Jaroschek
vit dans un petit village de la région du Pic Saint Loup, au nord de
Montpellier. Sous ses pas de promeneuse, sous ses pas de danseuse, elle
soulève des mots qui, parfois, au terme de longs détours intérieurs,
méandres, sédimentations, oubli, travail incorporé, fabrique de clairières,
parviennent à s’échapper pour composer le poème. Pour elle, écrire est la
mise en forme des traces que le corps dessine dans l’espace du monde, le
corps expression poétique de soi et des autres, au contact de la nature, des
éléments, des paysages… Parution aux éditions Souffles -
à l’abri
dans les nuits, Grand Prix de Poésie des 67èmes jeux
littéraires de l’Association des Écrivains Méditerranéens, octobre 2009 Parution aux éditions Encre et lumière -
la
brèche de l’air, recueil de poèmes avec des dessins de Pascal Thouvenin, septembre 2011 -
survivance
de la neige, Prix de poésie de la ville de Béziers
2012 Parution aux éditions La licorne -
aborder
les lointains, Prix d’Estieugues
2014 Parution aux éditions Henry - ici soudain, Prix des Trouvères
2018, juré des lycéens Parutions en revue et anthologies -
depuis 2006 contribution régulière à la revue Souffles -
depuis 2010, date de sa création, contribution régulière à la revue La
main millénaire -
depuis 2015 participation annuelle à l’Anthologie des Amis de
l’Écritoire d’Estieugues -
contribution au numéro 8 de la Revue Encre en mai 2021 -
contribution à l’ Anthologie des Voix de l’extrême en 2020, l’Anthologie internationale Mujeres Libres en 2021 (éd Tapuscrits) et L’éphémère,
Frontières -
les Anthologies Je dis Désirs et Paysage imaginaire, éd.
PSVT 2021 et 2022 -
contribution au numéro 2 de la Revue la Forge (éd. de Corlevour) février 2024 Parution aux éditions Alcyone 2022
- à mains nues Revues en ligne : Terre à ciel, Recours au poème, Revue Poétictac, Revue hélas.
Livres
d’artistes :
- Tango, embellies,
naufrage, long poème en fragments,
illustré par Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières D. Toiles, 2005
- Novembre, texte en
prose accompagné de photos de Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières
D. Toiles, 2006 -
L’espace d’un souffle, quatre
recueils de haïkus, au fil des saisons, inspirés des paysages de la région du
Pic St loup, peintures de Catherine Bergerot Jones, éditions Poussière D.
toiles, 2005 à 2008 -
Marines, recueils
de poèmes illustrés par Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières D.
Toiles 2009 Le 19 novembre 2022 : reçoit le
prix Paul Valéry de l’Académie Via Domitia Pierre
Paul Riquet pour l’ensemble de son œuvre. |
|
Ida Jaroschek Francopolis printemps 2025 Recherche Éric
Chassefière |
|
Accueil ~ Comité Francopolis ~ Sites Partenaires ~ La charte ~ Contacts |
Créé le 1er mars 2002